20 personnes présentes
Sujets proposés :
- S’engager, est ce perdre ou affirmer sa liberté ? [6]
- Pourquoi est ce si difficile de faire changer les choses ? [2]
- 3) Le langage permet-il seulement de communiquer ? [5]
- Le langage est-il un obstacle à la connaissance ? [2]
- La vie a-t-elle un sens ? [8] sujet débattu
- L’important est-il d’être constant ? [4]
- L’écologie est-elle un luxe de pays riche ? [4]
sens (direction) [sãs] n. m. 1. Orientation donnée à une chose. Disposer une couverture dans le sens de la longueur. ¶ Loc. Sens [s] dessus dessous : de manière que ce qui devrait être dessus se trouve dessous ; par ext., dans un grand désordre. Sens [s] devant derrière : de façon que ce qui devrait être devant se trouve derrière. 2. Axe suivant lequel on exerce une action sur une chose, et qui est défini par rapport à un ou à plusieurs éléments de cette chose. Couper du tissu dans le sens des fils. 3. Orientation d’un déplacement. Nager dans le sens du courant. Le sens de la marche d’un train. (Voie à) sens unique : voie sur laquelle la circulation n’est autorisée que dans un seul sens. Panneau de sens interdit. . MATH Orientation d’un vecteur le long de son support. Sens direct ou sens trigonométrique : sens inverse de celui des aiguilles d’une montre. ¶ Fig. Toutes ces recherches vont dans le même sens. Le sens de l’histoire.
sens (sensation) [sãs] n. m. I. 1. Faculté d’éprouver des sensations d’un certain ordre (visuelles, auditives, tactiles, olfactives, gustatives) et, en conséquence, de percevoir les réalités matérielles. Les organes des sens. Le sixième sens : l’intuition. Fig. Cela tombe sous le sens : c’est évident. . RELIG Peine du sens : peine du feu, pour les damnés (par oppos. à peine du dam). 2. Plur. Les plaisirs des sens : les plaisirs liés aux sensations physiques, spécial. dans le sens du plaisir sexuel. ¶ L’éveil des sens, de la sexualité. 3. Le sens de. Connaissance spontanée, intuitive. Avoir le sens des nuances, de l’hospitalité, du commerce. Sens pratique : habileté à résoudre les problèmes de la vie quotidienne. 4. Bon sens : capacité de bien juger. Un homme de bon sens. 5. Manière de juger, de voir les choses. Abonder dans le sens de qqn. À mon sens : à mon avis. ¶ Sens commun : ensemble des jugements communs à tous les hommes. Cela choque le sens commun. II. 1. Idée, concept représenté par un signe ou un ensemble de signes. Sens d’un geste. Sens propre, sens figuré d’un mot. Un faux sens : une interprétation erronée du sens d’un mot. 2. Caractère intelligible de qqch, permettant de justifier son existence. S’interroger sur le sens de la vie.
TEXTES SUR L’ABSURDITE, DIEU, LA RELIGION ET L’ILLUSION
– S. Freud, Malaise dans la civilisation
« Telle qu’elle nous est imposée, notre vie est trop lourde, elle nous inflige trop de peines, de déceptions, de tâches insolubles. Pour la supporter, nous ne pouvons pas nous passer de sédatifs. (Cela ne va pas sans »échafaudages de secours », a dit Théodor Fontane). Ils sont peut-être de trois espèces : d’abord de fortes diversions, qui nous permettent de considérer notre misère comme peu de chose, puis des satisfactions substitutives qui l’amoindrissent ; enfin des stupéfiants qui nous y rendent insensibles. L’un ou l’autre de ces moyens nous est indispensable. C’est aux diversions que songe Voltaire quand il formule dans Candide, en guise d’envoi, le conseil de cultiver notre jardin ; et c’est encore une diversion semblable que le travail scientifique. Les satisfactions substitutives, celles par exemple que nous offre l’art, sont des illusions au regard de la réalité ; mais elles n’en sont psychiquement pas moins efficaces, grâce au rôle assumé par l’imagination dans la vie de l’âme. Les stupéfiants, eux, influent sur notre organisme, en modifient le chimisme. […]. Quels sont les desseins et les objectifs vitaux qui sont trahis par la conduite des hommes, que demandent-ils à la vie, et à quoi tendent-ils ? On n’a guère de chance de se tromper en répondant : ils tendent au bonheur ; les hommes veulent être heureux et le rester. Cette aspiration a deux faces, un but négatif et un but positif : d’un côté éviter douleur et privation de joie, de l’autre rechercher de fortes jouissances. En un sens plus étroit, le terme « bonheur » signifie seulement que ce second but a été atteint. En corrélation avec cette dualité de buts, l’activité des hommes peut prendre deux directions, selon qu’ils cherchent – de manière prépondérante ou même exclusive – à réaliser l’un ou l’autre. On le voit, c’est simplement le principe du plaisir qui détermine le but de la vie, qui gouverne dès l’origine les opérations de l’appareil psychique ; aucun doute ne peut subsister quant à son utilité, et pourtant l’univers entier – le macrocosme aussi bien que le microcosme – cherche querelle à son programme. Celui-ci est absolument irréalisable ; on serait tenté de dire qu’il n’est point entré dans le plan de la « création » »
(S. Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, 1971, pp 18-19)
– Sartre, L’existentialisme est un humanisme
Lorsqu’on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe papier, cet objet a été fabriqué par un artisan qui s’est inspiré d’un concept : il s’est référé au concept de coupe-papier, et également à une technique de production préalable qui fait partie du concept, et qui est au fond une recette. Ainsi le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d’une certaine manière et qui, d’autre part, a une utilité définie ; et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l’objet va servir. Nous dirons donc que pour le coupe-papier, l’essence – c’est-à-dire l’ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir – précède l’existence, et ainsi la présence, en face de moi, de tel coupe-papier ou de tel livre est déterminée. Nous avons donc là une vision technique du monde, dans laquelle on peut dire que la production précède l’existence. […]
L’existentialisme athée, que je représente, […] déclare que si Dieu n’existe pas, il y a au moins un être chez qui l’existence précède l’essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et que cet être c’est l’homme, ou comme dit Heidegger, la réalité humaine.
Qu’est-ce que signifie ici que l’existence précède l’essence ? Cela signifie que l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu’il se définit après. L’homme tel que le conçoit l’existentialiste, s’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi, il n’y a pas de nature humaine, puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. L’homme est seulement, non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il se conçoit après l’existence, comme il se veut après cet élan vers l’existence ; l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait.
L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d’être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur ; rien n’existe préalablement à ce projet ; rien n’est au ciel intelligible, et l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté d’être. Non pas ce qu’il voudra être. Car ce que nous entendons ordinairement par vouloir, c’est une décision consciente, et qui est pour la plupart d’entre nous postérieure à ce qu’il s’est fait lui-même. Je peux vouloir adhérer à un parti, écrire un livre, me marier, tout cela n’est qu’une manifestation d’un choix plus originel, plus spontané que ce qu’on appelle volonté. Mais si vraiment l’existence précède l’essence, l’homme est responsable de ce qu’il est.
(Sartre, L’existentialisme est un humanisme [1946], Nagel, 1970, pp. 17-24)
« Dostoïevski avait écrit : « si Dieu n’existait tout serait permis. » C’est là le point de départ de l’existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n’existe pas, et par conséquent l’homme est délaissé, par ce qu’il ne trouve ni en lui, ni hors de lui une possibilité de s’accrocher. Il ne trouve d’abord pas d’excuses. Si en effet l’existence précède l’essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée ; autrement dit, il n’y a aps de déterminisme, l’homme est libre, l’homme est liberté. Si, d’autre part, Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite.
Ainsi nous n’avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. C’est ce que j’exprimerai en disant que l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas crée lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait. L’existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion. Il ne pensera jamais qu’une belle passion est un torrent dévastateur qui conduit fatalement l’homme à certains actes et qui, par conséquent est une excuse. Il pense que l’homme est responsable de sa passion. L’existentialisme ne pensera pas non plus que l’homme peut trouver un secours dans un signe donné, sur terre, qui l’orientera ; car il pense que l’homme déchiffre lui-même le signe comme il lui plaît. Il pense donc que l’homme, sans aucun appui et sans aucun secours, est condamné à chaque instant à inventer l’homme ».
(Sartre [1905-1980], L’existentialisme est un humanisme [1946], Nagel, pp. 36-38.)
– Merleau-Ponty, Sens et non-sens
Il y a là-dessus [sur la question du rapport entre l’homme et son entourage naturel ou social] deux vues classiques. L’une consiste à traiter l’homme comme le résultat des influences physiques, physiologiques et sociologiques qui le détermineraient du dehors et feraient de lui une chose entre les choses. L’autre consiste à reconnaître dans l’homme, en tant qu’il est esprit et construit la représentation des causes mêmes qui sont censées agir sur lui, une liberté acosmique. D’un côté l’homme est une partie du monde, de l’autre il est conscience constituante du monde. Aucune de ces deux vues n’est satisfaisante. A la première on opposera toujours d’après Descartes que, si l’homme n’était qu’une chose parmi les choses, il ne saurait en connaître aucune, puisqu’il serait, comme cette chaise ou cette table, enfermé dans ses limites, présent en un certain lieu de l’espace et donc incapable de se les représenter tous. Il faut lui reconnaître une manière d’être particulière, l’être intentionnel, qui consiste à viser toutes choses et à ne demeurer en aucune. Mais si l’on voudrait conclure de là que, par notre fond, nous sommes esprit absolu, on rendrait incompréhensibles nos attaches corporelles et sociales, notre insertion dans le monde, on renoncerait à penser la condition humaine. Le mérite de la philosophie nouvelle est justement de chercher dans la notion d’existence le moyen de la penser. L’existence au sens moderne, c’est le mouvement par lequel l’homme est au monde, s’engage dans une situation physique et sociale qui devient son point de vue sur le monde. Tout engagement est ambigu, puisqu’il est à la fois l’affirmation et la restriction d’une liberté : je m’engage à rendre ce service, cela veut dire à la fois que je pourrais ne pas le rendre et que je décide d’exclure cette possibilité. De même mon engagement dans la nature et dans l’histoire est à la fois une limitation de mes vues sur le monde et ma seule manière d’y accéder, de connaître et de faire quelque chose. Le rapport du sujet à l’objet n’est plus ce rapport de connaissance dont parlait l’idéalisme classique et dans lequel l’objet apparaît toujours comme construit par le sujet, mais un rapport d’être selon lequel paradoxalement le sujet est son corps, son monde et sa situation.
(Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Nagel, 1945, pp. 142-144)
– Pascal, Pensées
« La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C’est donc être misérable que de se connaître misérable ; mais c’est être grand que de connaître qu’on est misérable. Pensée fait la grandeur de l’homme.
Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête (car ce n’est que l’expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds). Mais je ne puis concevoir l’homme sans pensée : ce serait une pierre ou une brute. […]
L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il nous faut relever et non de l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. » (Pascal, Pensées)
Il ne faut pas avoir l’âme fort élevée pour comprendre qu’il n’y a point ici de satisfaction véritable et solide, que tous nos plaisirs ne sont que vanité, que nos maux sont infinis, et qu’enfin la mort qui nous menace à chaque instant, doit infailliblement nous mettre dans peu d’années dans l’horrible nécessité d’être éternellement ou anéanti ou malheureux […].
Qu’on fasse réflexion là-dessus et qu’on dise ensuite s’il n’est pas indubitable qu’il n’y a de bien en cette vie qu’en l’espérance d’une autre vie, qu’on est heureux qu’à mesure qu’on s’en approche […]
Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que moi-même ; je suis dans une ignorance terrible de toutes choses ; je ne sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j’ignore le plus est cette mort que je ne saurais éviter.
Comme je ne sais d’où je viens, aussi je ne sais où je vais ; et je sais seulement qu’en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage. Voilà mon état, plein de faiblesse et d’incertitude. Et de tout cela je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à chercher ce qui doit m’arriver.
(Blaise Pascal, Pensées, Pléiade – Gallimard, 1954, pp. 1174-1175).
– Emmanuel Kant, Critique de la raison pure
« Je ne saurais donc admettre Dieu, la liberté et l’immortalité selon le besoin qu’en a ma raison dans son usage pratique nécessaire, sans repousser en même temps les prétentions de la raison pure à des vues transcendantes, car, pour atteindre à ces vues, il lui faut se servir de principes qui ne s’étendent en réalité qu’à des objets de l’expérience possible et qui, si on les applique à une chose qui ne peut être objet d’une expérience, la transforment réellement et toujours en phénomène, et déclarent ainsi impossible toute extension pratique de la raison pure. J’ai donc dû supprimer le savoir pour lui substituer la croyance. Le dogmatisme de la métaphysique, ce préjugé qui consiste à vouloir avancer dans cette science sans commencer par une critique de la raison pure, voilà la véritable source de toute cette incrédulité qui s’oppose à la morale, et qui elle-même est toujours très dogmatique. (…) (…) Si (…) cette remarquable disposition naturelle à tout homme, qui fait que rien de temporel ne saurait le satisfaire (parce que ne suffisant pas aux besoins de sa destinée complète), peut seule faire naître l’espérance d’une vie future ; si (…) la claire représentation de nos devoirs, en opposition à toutes les exigences de nos penchants, nous donne seule la conscience de notre liberté ; si (…) l’ordre magnifique, la beauté et la prévoyance qui éclatent de toutes parts dans la nature sont seuls capables de produire la croyance en un sage et puissant auteur du monde, et une conviction fondée sur des principes rationnels et susceptible de pénétrer dans le public ; alors seulement le domaine de la raison demeure intact, mais elle gagne en considération par cela seul qu’elle instruit les écoles à ne plus prétendre, sur une question qui touche à l’intérêt général de l’humanité, à des vues plus élevées et plus étendues que celles auxquelles peut facilement arriver le grand nombre (lequel est parfaitement digne de notre estime), et à se borner ainsi à la culture de ces preuves que tout le monde peut comprendre et qui suffisent au point de vue moral (…).
La critique peut seule couper les racines du matérialisme, du fatalisme, de l’athéisme, de l’incrédulité des esprits forts, du fanatisme et de la superstition, ces fléaux qui peuvent devenir nuisibles à tous, comme aussi de l’idéalisme et du scepticisme, qui [du moins] ne sont guère dangereux qu’aux écoles et pénètrent difficilement dans le public. Si [es gouvernements jugeaient à propos de se mêler des affaires des savants, ils feraient beaucoup plus sagement, dans leur sollicitude pour [es sciences aussi bien que pour les hommes, de favoriser la liberté d’une critique qui seule est capable d’établir sur une base solide les travaux de la raison, que de soutenir le ridicule despotisme des écoles, toujours prêtes à dénoncer à grands cris un danger public, quand on déchire leurs toiles d’araignée, dont le public n’a jamais entendu parler et dont il ne peut pas même, par conséquent, sentir la perte. »
(Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, préface de la seconde édition, trad. Barni, Garnier-Flammarion, pp. 48-49.)
– G. Pascal, Pour connaître la pensée de Kant
« Selon que l’on considère l’esprit critique et positif de Kant ou son idéalisme moral, on pourra traduire de deux façons la phrase célèbre de la Préface de la 2e édition de la CRP Barni traduit : « J’ai dû supprimer le savoir pour lui substituer la croyance », ce qui implique un regret de ne pas savoir et l’acceptation de la croyance comme d’un pis-aller. Tremesaygues-Pacaud traduisent : « Je dus abolir le savoir afin d’obtenir une place pour la croyance », ce qui implique que croire est au-dessus de savoir. Les deux traductions sont également bonnes et cette ambiguïté est pleinement caractéristique du génie d’un philosophe qui ne voulait sacrifier ni à la lucidité, ni à la foi. »
(G. Pascal, Pour connaître la pensée de Kant, PUF, p.195.)
– Karl Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel
« Voici le fondement de la critique de la religion : l’homme fait la religion, la religion ne fait pas l’homme. Et en effet, la religion est la conscience et le sentiment de l’homme qui ne s’est pas encore trouvé ou qui s’est déjà repété ; Niais l’homme, ce n’est pas un être abstrait, extérieur au monde. L’homme, c’est le monde de l’homme, l’État, la Société. Cet État, cette société, produisent la religion, conscience pervertie du monde, parce qu’ils sont un monde perverti. La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son « point d’honneur » spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son solennel complément, sa raison générale de consolation et de justification. Elle est la réalisation fantastique de l’essence humaine, parce que l’essence humaine n’a pas de véritable réalité. La lutte contre la religion est donc une lutte indirecte contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, le coeur d’un monde sans coeur, comme elle est l’esprit d’un temps sans esprit. Elle est l’opium du peuple. »
(Karl Marx, « Critique de la philosophie du droit de Hegel », in Morceaux choisis, Lefebvre et Guterman, Gallimard, 1939, p. 221.)
– Karl Marx, Critique de la philosophie hégélienne du droit
« La suppression de la religion comme bonheur illusoire du peuple est l’exigence de son bonheur réel. L’exigence de renoncer aux illusions sur son état est l’exigence de renoncer à un état qui a besoin des illusions. La critique de la religion est ainsi en germe la critique de la vallée de larmes, dont la religion est l’auréole. La critique a arraché de la chaîne les fleurs imaginaires, non pour que l’homme porte la chaîne prosaïquement, sans consolation, mais afin qu’il rejette la chaîne et cueille la fleur vivante. La critique de la religion désillusionne l’homme, afin qu’il pense, agisse, façonne sa propre réalité comme un homme désillusionné, ayant accédé à la raison, afin qu’il gravite autour de soi-même et par là, autour de son véritable soleil. La religion n’est que le soleil illusoire, qui se meut autour de l’homme, tant que celui-ci ne gravite pas autour de lui-même. La critique n’a pas besoin de chercher à s’expliquer avec cet objet, car elle sait ce qu’elle doit en penser. Elle ne se donne plus comme une fin en soi, mais simplement comme un moyen. Sa passion essentielle est l’indignation, sa tâche essentielle la dénonciation. »
(Karl Marx, Critique de la philosophie hégélienne du droit, in Œuvres choisies, T.l, Idées-Gallimard, pp. 39-40.)
– Sigmund Freud, « D’une conception de l’univers »
« La psychanalyse a fourni à la critique de la conception religieuse du monde un dernier argument en montrant que la religion doit son origine à la faiblesse de l’enfant et en attribuant son contenu aux désirs et aux besoins infantiles encore subsistants à l’âge adulte. Il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’une réfutation de la religion, mais bien d’une mise au point nécessaire de nos connaissances en ce qui la concerne. Nous ne sommes en contradiction avec elle que lorsqu’elle se targue de son origine divine, ce en quoi d’ailleurs elle n’a pas tort si l’on admet notre explication de la divinité. »
(Sigmund Freud, « D’une conception de l’univers », in Nouvelles conférences sur la psychanalyse, trad. Anne Berman, Idées-Gallimard, 1975, p. 221.)
– Sigmund Freud, L’Avenir d’une illusion
Je vous prie de noter la différence entre votre attitude et la mienne en face de l’illusion. Vous devez défendre de toutes vos forces l’illusion religieuse : si elle vient à être discréditée – et elle est vraiment assez menacée- alors votre univers s’écroule, il ne vous reste qu’à désespérer de tout, de la civilisation et de l’avenir de l’humanité. Je suis, nous sommes libres d’un tel servage. Etant préparés à renoncer à une bonne part de nos désirs infantiles, nous pouvons supporter que certaines de nos espérances se révèlent comme étant des illusions. »
(Sigmund Freud, L’Avenir d’une illusion, trad. Marie Bonaparte, PUF, 1980, p. 78.)
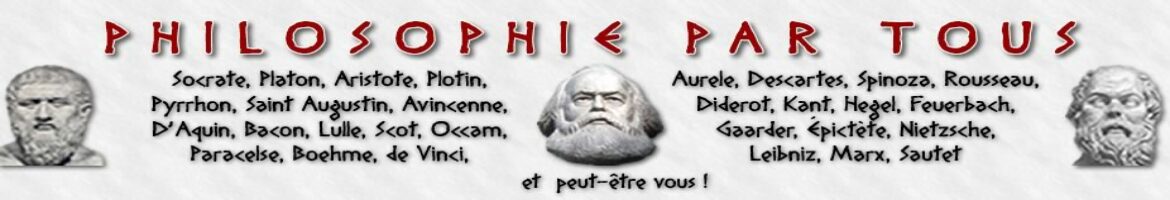
1 Commentaire
S’engager, est ce perdre ou affirmer sa liberté ?