7 personnes présentes.
Sujets proposés :
- À quoi ça sert d’aimer ? [6] sujet débattu
- La femme cette autre homme [5]
- La pensée empêche-t-elle d’agir ? [1]
- Faut-il croire au destin ? [2]
Textes
Nous distinguerons trois types fondamentaux de comportements : les réflexes, les instincts et les comportements désirant. Une vieille expérience de Bard met bien en évidence ce qui les différencie. Lorsqu’on touche les régions sexuelles d’une chatte avec un bâtonnet, l’animal réagit différemment selon qu’il est ou non en chaleur. La chatte castrée ou au repos sexuel écarte l’importun ; la chatte en chaleur ou ayant reçu des hormones accepte au contraire l’hommage de l’expérimentateur par un comportement d’élévation de l’arrière-train, de flexion-extension des membres postérieurs et de latéralisation de la queue. Lorsqu’on sépare la moelle épinière du cerveau par une section du tronc cérébral, on observe que l’animal répond à chacune des stimulations vaginales par le comportement décrit plus haut, quel que soit son état interne. C’est un réflexe. Les choses se passent différemment si la section du système nerveux est pratiquée de façon à laisser en contact la moelle épinière et la partie basse du cerveau : la réponse à la stimulation vaginale est alors, comme chez l’animal intact, fonction de l’état interne, c’est-à-dire de la présence d’hormones sexuelles dans le sang : elle ne se produit pas chez l’animal castré mais apparaît après injection d’hormones. Un instinct est ici à l’œuvre. Il nécessite pour son déclenchement la coexistence d’un état interne particulier et d’un centre nerveux où s’intègrent les influences du premier. Si, pour finir, nous considérons une chatte préservée des manœuvres vivisectrices, nous observons qu’à certains moments de l’année notre amie, oubliant ses obligations domestiques, déploie une ingéniosité sans pareille à déjouer les pires obstacles pour finalement se mettre en position à l’intention de quelque matou anonyme, sur une gouttière sans attrait : c’est un comportement désirant. Dans cet exemple, nous constatons que le même comportement figure pareillement au titre de réflexe, d’instinct et de comportement désirant dans la panoplie des réponses à un identique stimulus sexuel. (Jean-Didier Vincent, Biologie des passions, Points-Seuil, 1986, p. 164)
Il y avait six mois qu’elle vivait seule, c’est-à-dire loin de son amant et de son mari ; il y en avait trois que je la voyais presque tous les jours, et toujours l’amour en tiers entre elle et moi. Nous avions soupé tête-à-tête, nous étions seuls, dans un bosquet au clair de lune, et après deux heures de l’entretien le plus vif et le plus tendre, elle sortit au milieu de la nuit de ce bosquet et des bras de son ami, aussi intacte, aussi pure de corps et de cœur qu’elle y était entrée. Lecteur, pesez toutes ces circonstances, je n’ajouterai rien de plus. Et qu’on n’aille pas s’imaginer qu’ici mes sens me laissaient tranquille, comme auprès de Thérèse et de Maman. Je l’ai déjà dit, c’était de l’amour cette fois, et l’amour dans toute son énergie et dans toutes ses fureurs. Je ne décrirai ni les agitations, ni les frémissements, ni les palpitations, ni les mouvements convulsifs, ni les défaillances de cœur que j’éprouvais continuellement ; on en pourra juger par l’effet que sa seule image faisait sur moi. J’ai dit qu’il y avait loin de l’Hermitage à Eaubonne : je passais par les coteaux d’Andilly, qui sont charmants. Je rêvais en marchant à celle que j’allais voir, à l’accueil caressant qu’elle me ferait, au baiser qui m’attendait à mon arrivée. Ce seul baiser, ce baiser funeste, avant même de le recevoir, m’embrasait le sang à tel point que ma tête se troublait, un éblouissement m’aveuglait, mes genoux tremblants ne pouvaient me soutenir ; j’étais forcé de m’arrêter, de m’asseoir ; toute ma machine était dans un désordre inconcevable, j’étais prêt à m’évanouir. Instruit du danger, je tâchais en partant de me distraire et de penser à autre chose. Je n’avais pas fait vingt pas que les mêmes souvenirs et tous les accidents qui en étaient la suite revenaient m’assaillir sans qu’il me fût possible de m’en délivrer, et de quelque façon que je m’y sois pu prendre, je ne croîs pas qu’il me soit jamais arrivé de faire seul ce trajet impunément. J’arrivais à Eaubonne, faible, épuisé, rendu, me soutenant à peine. A l’instant que je la voyais tout était réparé : je ne sentais plus auprès d’elle que l’importunité d’une vigueur inépuisable et toujours inutile. Il y avait sur ma route, à la vue d’Eaubonne, une terrasse agréable, appelée le mont Olympe, où nous nous rendions quelquefois, chacun de notre côté. J’arrivais le premier, j’étais fait pour l’attendre ; mais que cette attente me coûtait cher ! Pour me distraire, j’essayais d’écrire avec mon crayon des billets que j’aurais pu tracer du plus pur de mon sang : je n’en ai pu jamais achever un qui fut lisible. Quand elle en trouvait quelqu’un dans la niche dont nous étions convenus, elle n’y pouvait voir autre chose que l’état vraiment déplorable ou j’étais en l’écrivant. Cet état, et surtout sa durée, pendant trois mois d’irritation continuelle et de privation, me jeta dans un épuisement dont je n’ai pu me tirer de plusieurs années, et finit par me donner une descente [hernie] que j’emporterai ou qui me portera au tombeau. Telle a été la seule jouissance amoureuse de l’homme au tempérament le plus combustible, mais le plus timide en même temps, que peut-être la nature ait jamais produit. Tels ont été les derniers beaux jours qui m’avaient été comptés sur la terre : ici commence le long tissu des malheurs de ma vie, où l’on verra peu d’interruption. (Jean-Jacques Rousseau, Confessions, Livre IX, Pléiade-Gallimard, pp. 444-446.)
[…] Et plus le temps nous fait cortège
Et plus le temps nous fait tourment
Mais n’est-ce pas le pire piège
Que vivre en paix pour des amants
Bien sûr tu pleures un peu moins tôt
Je me déchire un peu plus tard
Nous protégeons moins nos mystères
On laisse moins faire le hasard
On se méfie du fil de l’eau
Mais c’est toujours la tendre guerre […]
(Jacques Brel, Chanson des vieux amants)
Le tort causé par la frustration initiale de la jouissance sexuelle se manifeste dans le fait que celle-ci, rendue plus tard libre dans le mariage, n’a plus d’effet pleinement satisfaisant. Mais la liberté sexuelle illimitée accordée dès le début ne conduit pas à un meilleur résultat. Il est facile d’établir que la valeur psychique du besoin amoureux baisse dès que la satisfaction lui est rendue facile. Il faut un obstacle pour faire monter la libido, et là où les résistances naturelles à la satisfaction ne suffisent pas, les hommes en ont, de tout temps, introduit de conventionnelles pour pouvoir jouir de l’amour. […] A-t-on jamais entendu dire que le buveur fût contraint de changer sans cesse de boisson parce qu il se lasserait d’une boisson qui resterait la même ? Au contraire l’accoutumance resserre toujours davantage le lien entre l’homme et la sorte de vin qu’il boit. Existe-t-il chez le buveur un besoin d’aller dans un pays où le vin soit plus cher ou sa consommation interdite, afin de stimuler par de telles difficultés, sa satisfaction en baisse ? Absolument pas. Écoutons les propos de nos grands alcooliques, comme Bôcklin sur leur relation avec le vin ; ils évoquent l’harmonie la plus pure et comme un modèle de mariage heureux. Pourquoi la relation de l’amant à son objet sexuel est-elle si différente ? Aussi étrange que cela paraisse, je crois que l’on devrait envisager la possibilité que quelque chose dans la nature même de la pulsion sexuelle ne soit pas favorable à la réalisation de la pleine satisfaction. […] Premièrement, en raison de l’instauration en deux temps du choix d’objet avec, entre les deux, l’intervention de la barrière contre l’inceste, l’objet final de la pulsion sexuelle n’est plus l’objet originaire, mais seulement son substitut. Or, la psychanalyse nous a appris ceci : lorsque l’objet originaire d’une motion de désir s’est perdu à la suite d’un refoulement, il est fréquemment représenté par une série infinie d’objets substitutifs, dont aucun ne suffit pleinement. Voilà qui nous expliquerait l’inconstance dans le choix d’objet, la « faim d’excitation », qui caractérisent si fréquemment la vie amoureuse des adultes. En second lieu, nous savons que la pulsion sexuelle, au début se divise en une grande série de composantes – ou plutôt, provient d’une telle série – dont toutes ne pourront être intégrées dans sa configuration ultérieure, mais devront auparavant être réprimées ou utilisées autrement. Ce sont avant tout les composantes pulsionnelles coprophiliques qui se sont avérées incompatibles avec les exigences esthétiques de notre civilisation, vraisemblablement depuis que passant à la station debout, nous avons élevé au-dessus du sot notre organe olfactif ; puis une bonne partie des impulsions sadiques qui appartiennent à la vie amoureuse. (Sigmund Freud « Psychologie de la vie amoureuse », La vie sexuelle, traduction de Denise Berger et Jean Laplanche, PUF, 1969, p.63-64.)
« Telle qu’elle nous est imposée, notre vie est trop lourde, elle nous inflige trop de peines, de déceptions, de tâches insolubles. Pour la supporter, nous ne pouvons pas nous passer de sédatifs. (Cela ne va pas sans »échafaudages de secours », a dit Théodor Fontane). Ils sont peut-être de trois espèces : d’abord de fortes diversions, qui nous permettent de considérer notre misère comme peu de chose, puis des satisfactions substitutives qui l’amoindrissent ; enfin des stupéfiants qui nous y rendent insensibles. L’un ou l’autre de ces moyens nous est indispensable. C’est aux diversions que songe Voltaire quand il formule dans Candide, en guise d’envoi, le conseil de cultiver notre jardin ; et c’est encore une diversion semblable que le travail scientifique. Les satisfactions substitutives, celles par exemple que nous offre l’art, sont des illusions au regard de la réalité ; mais elles n’en sont psychiquement pas moins efficaces, grâce au rôle assumé par l’imagination dans la vie de l’âme. Les stupéfiants, eux, influent sur notre organisme, en modifient le chimisme. […]. Quels sont les desseins et les objectifs vitaux qui sont trahis par la conduite des hommes, que demandent-ils à la vie, et à quoi tendent-ils ? On n’a guère de chance de se tromper en répondant : ils tendent au bonheur ; les hommes veulent être heureux et le rester. Cette aspiration a deux faces, un but négatif et un but positif : d’un côté éviter douleur et privation de joie, de l’autre rechercher de fortes jouissances. En un sens plus étroit, le terme « bonheur » signifie seulement que ce second but a été atteint. En corrélation avec cette dualité de buts, l’activité des hommes peut prendre deux directions, selon qu’ils cherchent – de manière prépondérante ou même exclusive – à réaliser l’un ou l’autre. On le voit, c’est simplement le principe du plaisir qui détermine le but de la vie, qui gouverne dès l’origine les opérations de l’appareil psychique ; aucun doute ne peut subsister quant à son utilité, et pourtant l’univers entier – le macrocosme aussi bien que le microcosme – cherche querelle à son programme. Celui-ci est absolument irréalisable ; on serait tenté de dire qu’il n’est point entré dans le plan de la « création » » (S. Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, 1971, pp 18-19)
Nous avons signalé plus haut ce fait d’expérience que l’amour sexuel (génital) procure à l’être humain les plus fortes satisfactions de son existence et constitue pour lui à vrai dire le prototype de tout bonheur ; et nous avons dit que de là à rechercher également le bonheur de la vie dans le domaine des relations sexuelles et à placer l’érotique génitale au centre de cette vie, il aurait dû n’y avoir qu’un pas. Nous ajoutions qu’en s’engageant dans cette voie on se rendait ainsi, et de la manière la plus inquiétante, dépendant d’une partie du monde extérieur, à savoir de l’objet aimé, et que l’on était exposé à une douleur intense du fait de son dédain ou de sa perte s’il était infidèle ou venait à mourir. C’est pourquoi les sages de tous les temps ont déconseillé cette voie avec tant d’insistance – mais en dépit de leurs efforts, elle n’a rien perdu de son attrait pour un grand nombre des enfants des hommes. (Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, traduction par Ch. et J. Odier, PUF 1971, p. 52.)
Définition de l’état amoureux Être amoureux, un état qui peut durer une heure ou une éternité – iceberg de chimie et d’imaginaire dont le comportement sexuel n’est que la partie émergée. Qui oserait prétendre que l’amour se réduit à une gymnastique copulatoire et à quelques grimaces préliminaires ? Mais ce sont les seuls phénomènes observables et – il faut bien nous y résoudre -, d’amour, il sera moins question par la suite que de comportement sexuel : Nous retrouverons dans l’état amoureux les trois dimensions d’un état central : le corporel, l’extracorporel et le temporel. Être amoureux exige la présence – réelle ou imaginée – de l’autre en tant qu’objet de désir au sein de l’espace extracorporel. Le paradoxe de l’amour est que cet objet est lui-même constitué d’un état central, autrement dit que l’espace extracorporel de l’un est occupé par l’espace corporel de l’autre. L’autre n’est pas indifférent. L’amour exige une réciprocité et le désir de l’un est fonction du désir de l’autre. Un chien et une chienne appartenant à un même maître cohabitent dans un respect poli tout au long de l’année ; à de brèves périodes dites de chaleur ou d’œstrus, un changement d’état chez la femelle transforme l’indifférent en amant. L’état central de la femelle a induit l’état amoureux du mâle – « ce que j’aime, c’est ton amour… »
L’espace corporel L’état amoureux s’accompagne chez les deux partenaires d’une transformation du corps ; parfois spectaculaire, celle-ci se réduit le plus souvent à des bouleversements intimes qui touchent principalement les sécrétions hormonales et le fonctionnement du système nerveux central. Le rôle des glandes génitales est évidemment déterminant, comme en témoignent les effets de la castration. Les hormones sexuelles agissent directement sur le cerveau grâce à la présence de récepteurs dans les neurones. D’autres hormones, comme la prolactine et la lulibérine, interviennent également dans la genèse de l’état amoureux. Mais des testicules ou des ovaires regorgeant de sécrétions ne suffisent pas à engendrer le désir sexuel. Le désir est universel et lié au bon fonctionnement, à l’intérieur du cerveau, de systèmes désirants dont la sexualité n ’est qu’un des accomplissements. Enfin, l’appareil sexuel lui-même ne représente pas une composante indispensable de l’état amoureux ; voie finale commune, nécessaire aussi bien à la jouissance qu’a l’accomplissement de la fonction reproductrice, il n ’intervient pas, ou peu, dans la reconnaissance de l’autre, qui reste chez l’homme la fonction supérieure de l’amour. (Jean-Didier Vincent, Biologie des passions, Points-Seuil, Editions Odile Jacob, 1986, pp. 286-287.)
Dieu arpente son bureau, lorsqu’il aperçoit de sa baie vitrée le diable traînant derrière lui une vieille caisse. Intrigué, Dieu appelle son majordome et lui demande : « Qu’y a-t-il dans cette caisse ? » Ce dernier lui répond : « Un homme et une femme ». Dieu désemparé, consulte ses dossiers et, soudain, se souvient : »Ah oui… cette expérience ratée… Est-ce qu’ils vivent toujours ? (Roland Jaccard, L’expérience ratée, Le Magazine Littéraire, n°301, juillet-août 1992)
Les femmes ne sont attirantes que lorsqu’elles sont jeunes. Cela dure peu. Mais la nature les comble alors d’une beauté surabondante, à laquelle l’homme se laisse prendre. Cet attrait qu’elles exercent alors sur les hommes, cette plénitude qui les envahit au détriment du reste de leur vie, doit leur permettre de capter l’imagination d’un homme dans le peu de temps dont elles disposent pour le décider à s’occuper d’elles pour de bon toute sa vie. (Arthur Schopenhauer, Panerga et Paralipomena, chapitre 27, 378)
Car l’amour de l’homme décline insensiblement, à partir du moment où il a reçu satisfaction ; presque toutes les autres femmes l’attirent plus que celle qu’il possède déjà, il aspire au changement. L’amour de la femme, au contraire, augmente à partir de ce moment ; résultat conforme à la fin que se propose la nature, à savoir la conservation et l’accroissement aussi considérable que possible de l’espèce. L’homme peut, sans peine, engendrer en une année plus de cent enfants, s’il a à sa disposition un nombre égal de femmes tandis qu’une femme, même avec un pareil nombre d’hommes, ne pourrait toujours mettre au monde qu’un enfant dans l’année (les jumeaux étant l’exception). Aussi l’homme cherche-t-il toujours d’autres femmes ; la femme au contraire, s’attache fermement à un seul homme, car la nature la pousse sans réflexion à conserver celui qui doit nourrir et protéger l’enfant à naître. Ainsi donc la fidélité conjugale, tout artificielle chez l’homme, est naturelle chez la femme. (Arthur Schopenhauer, Monde comme volonté et comme représentation, supplément, chapitre 44.)
La femme exige et attend tout de l’homme. L’homme n’attend qu’une chose de la femme, immédiatement et tout de suite. Il a donc fallu trouver l’institution qui autorise l’homme à exiger cette chose et qui permette à la femme en échange d’être entièrement prise en charge avec les enfants nés de leur liaison. Pour l’imposer les femmes doivent impérativement faire preuve d’esprit de corps. (Arthur Schopenhauer, Aphorismes sur l’art de vivre, chapitre 4)
L’erreur du passionné consiste donc moins dans la surestimation de l’objet actuel de sa passion que dans la confusion de cet objet et de l’objet passé qui lui confère son prestige […]. Ainsi s’il est un amour action, qui veut le bien de ce qu’il aime, s’efforce donc de le rendre meilleur, de le transformer selon la valeur, il est un amour passion qui désire que son objet demeure ce qu’il est, et le prend pour mesure de la valeur elle-même […]. De celui-ci [le véritable amour] la passion nous détourne. Car l’amour véritable est action, et, comme toute action, il refuse de se soumettre, veut changer ce qui est, et lui préfère ce qui n’est pas encore, et participant à cette constante création qu’est le cours du monde, il entreprend de transformer l’être selon la valeur […]. En aimant le passé, nous n’aimons que notre propre passé, seul objet de nos souvenirs. On ne saurait aimer le passé d’autrui ; par contre l’amour peut se porter vers son avenir, et il le doit, car aimer vraiment, c’est vouloir le bien de l’être qu’on aime, et l’on ne peut vouloir ce bien que dans le futur. Tout amour passion, tout amour du passé, est donc illusion d’amour, et, en fait, amour de soi-même. Il est désir de se retrouver, et non de se perdre ; d’assimiler autrui, et non de se donner à lui ; il est infantile, possessif et cruel […]. L’amour action suppose au contraire l’oubli de soi, de ce que l’on fut ; il implique l’effort pour améliorer l’avenir de celui qu’on aime. (Ferdinand Alquié, Le désir d’éternité, PUF, date, p 54-56).
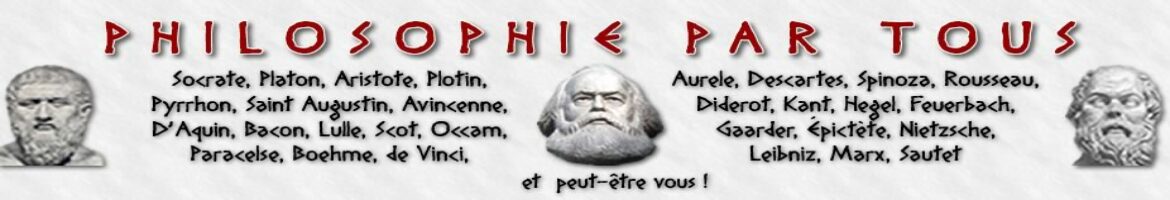
2 Commentaires
Heureusement que nous avons enfin la réponse et des mécanismes de l’amour depuis le XXe siécle, nous sommes sauvés. L’amour est-elle une chose générée par la civilisation au cette chose existe depuis la nuit des temps. Il ne faut pas confondre amour et sexe, il semble que certaines personnes font la distinction des deux. Il me semble que le “mystère” reste entier.
Biensûr, les êtres humains peuvent aimer, ressentir de l’affection pour des proches et amis. C’est une chose naturelle. Et cette affection, cet amour ressenti peut être plus ou moins fort et fait plus ou moins souffrir.
Il y a un texte de HUME extrait de son Traité de la nature humaine avec lequel je suis entièrement d’accord et qui éclaircie très bien la vérité des choses :
« Quelque inclination qu’on puisse éprouver pour autrui, ou qu’on s’imagine éprouver, aucun sentiment n’est et ne peut-être, désintéressé ; la plus généreuse amitié, malgré sa sincérité, est une modification de l’amour de soi ; même à notre insu, nous cherchons uniquement notre propre avantage au moment même où nous paraissons le plus profondément engagés en des plans pour la liberté et le bonheur de l’humanité. Par un tour de notre imagination, par une subtilité de notre réflexion, par un enthousiasme passioné, nous semblons prendre part aux intérêts d’autrui et nous nous imaginons dégagés de toute considération égoïste ; mais, au fond, le plus généreux patriote et l’avare le plus chiche, le héros le plus courageux et le poltron le plus méprisable ont dans toutes leurs actions, un souci égal de leur propre bonheur et de leur propre bien-être. »